Les médecins dans l'aventure saint-simonienne.
Par Jean Guénel, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Nantes.
Accès au contenu de ce dossier

Introduction
Dans le Dictionnaire des saint-simoniens en préparation sous la direction de Philippe Régnier, on relève environ soixante-dix médecins. Malheureusement, un grand nombre ne nous est connu que par un nom, parfois aussi un prénom ; les dates et lieux de leur naissance et de leur décès manquent souvent et l'on a peu de renseignements sur leur activité professionnelle. La plupart sont probablement de modestes praticiens qui n'ont pas fait parler d'eux, qui ont suivi sans doute avec enthousiasme l'enseignement des « missionnaires » envoyés par le Père et se sont ensuite efforcés avec plus ou moins de succès de transmettre la « bonne parole » à leur entourage. Reconstituer leur pensée, leur carrière professionnelle, leurs liens avec le saint-simonisme reste un travail difficile. Pour d'autres, qui ont joui d'une certaine notoriété universitaire ou politique quelques documents existent dans les bibliothèques ou les archives de leur ville natale ou de leur lieu d'exercice. L'abondante correspondance entre les membres de la « Famille » saint-simonienne conservée au fonds Enfantin de la bibliothèque de l'Arsenal fournit également quelques sources.
Les saint-simoniens en général ont été fascinés par la médecine, à preuve l'emploi fréquent qu'ils font du terme de physiologie en l'appliquant à des sujets non-médicaux comme la « physiologie de la société », « la physiologie de l'histoire » ou même la « physiologie de la religion ». On peut y voir un hommage rendu aux progrès des sciences médicales en ce début du XIXe siècle. Inversement, comment expliquer cette attraction de la doctrine saint-simonienne sur tant de médecins de cette époque ? Comment un tel mélange de divagations religieuses, de mysticisme, de sentimentalité et de poésie a-t-il pu coexister dans leur esprit avec la rationalité indispensable à la pratique de leur profession ? La notion chère à Saint-Simon du progrès continu de l'histoire de l'humanité, principalement dans le domaine des sciences, ne peut que les séduire. Le rôle attribué par la doctrine aux élites scientifiques dans le gouvernement de la nation flatte aussi leur sentiment d'appartenir à cette élite et, de fait, plusieurs d'entre eux ont joué plus tard un rôle politique tout au moins dans les instances locales.
Dans l'ensemble, leur formation médicale semble avoir été assez légère, mais il faut remarquer que plusieurs n'étaient que des officiers de santé qui jusqu'en 1838 ne passaient pas par les facultés de médecine et, formés sur le tas, recevaient leurs diplômes de commissions départementales peu exigeantes sur leurs connaissances. Toutefois les médecins-militaires ou les médecins de marine, comme Pellarin et Villers, formés dans leurs hôpitaux particuliers, sont en général de bonne qualité. Pour tous, y compris ceux qui sortent des facultés ou des écoles de médecine, la formation scientifique est souvent insuffisante. Il faut en excepter ceux qui, comme Buchez, ont suivi une formation préalable au Muséum d'Histoire naturelle de Paris ou comme Guépin et Perron, qui ont des connaissances suffisantes en physique et chimie pour enseigner ces disciplines. Ou encore Küss formé au contact de la médecine allemande, alors plus scientifique que la nôtre. Faut-il rappeler qu'à cette époque beaucoup de bons esprits pensent encore que les sciences fondamentales comme la physique, la chimie ou les statistiques n'apportent rien à la médecine ? Par contre, comment Simon peut-il, quand il s'entretient de médecine avec Enfantin, accepter sans réagir les élucubrations physiologiques du Père ? Ribes fait peu de cas de l'anatomie pathologique et quand en 1855, il discute encore sérieusement du vitalisme, la Société de biologie a été fondée sept ans auparavant. Que penser de la bizarre conception qu'a Imbert du rôle du système cérébro-spinal, dont il n'apporte pas la moindre preuve expérimentale ? La pratique de ces médecins reste traditionnelle, peu ouverte aux nouveautés. S'ils se sont dévoués dans les épidémies, comme à Paris en 1832 et quelques années plus tard en Égypte, la plupart n'en rejettent pas moins la théorie de la contagion d'homme à homme et restent attachés à la responsabilité des miasmes véhiculés par l'air ou au rôle des conditions météorologiques ou de la mauvaise alimentation. D'où leur rejet de la quarantaine en cas d'épidémie. Nos saint-simoniens sont parfois conscients de leur retard, qui s'accorde mal avec leur objectif d'une doctrine basée sur le progrès scientifique. Aussi plusieurs d'entre eux ont-ils conçu des projets pour la réforme de l'enseignement médical dont certains reflètent le bon sens comme l'introduction des sciences fondamentales dans le cursus avant l'entrée à la faculté.
Cette faible formation scientifique ne les protège pas contre des dérives vers des médecines irrationnelles. Guépin lui-même, esprit pourtant éclairé, participe à des séances de magnétisme et fait des conférences sur le sujet, ainsi que sur la phrénologie de Gall. Cognat croit aussi au magnétisme animal. Certains même gardent une ouverture sur le merveilleux, le spiritisme, le somnambulisme et autres phénomènes parapsychiques à l'exemple de Verrolot qui envoie en 1854 une lettre à Lambert pour lui faire part des recherches qu'il a entreprises sur les tables tournantes. Mais pour leur excuse, il faut signaler qu'en 1837 un membre de l'académie de médecine avait fondé un prix pour encourager les recherches sur les guérisons par le magnétisme. Ainsi l'utopie régnait encore en médecine.
Mais la raison primordiale de leur engagement dans la doctrine semble l'apparition en médecine de préoccupations sociales, qui n'existaient guère dans le passé. Au début du XIXe siècle, le médecin gagne une place de plus en plus importante dans la société, moins par son pouvoir de soigner, car la thérapeutique est encore inefficace, que par son intervention préventive en développant l'hygiène surtout dans les classes inférieures auxquelles Saint-Simon voulait qu'on s'intéressât. Plusieurs se montrent sensibles à l'inégalité des classes sociales devant la maladie et la mort. Guérir est toujours difficile, tandis que prévenir est le plus souvent assez aisé, disait Guépin dans une lettre à Ribes. On s'explique que plusieurs des médecins saint-simoniens aient écrit des traités d'hygiène et que durant l'épidémie de choléra de 1832, ils aient plaidé pour la création à Paris d'un système d'égouts et d'un réseau d'eau potable accessible à tous qui ne sera réalisé que bien plus tard. C'est aussi sous l'influence des saint-simoniens que verront le jour des caisses mutuelles de secours qui couvriront les honoraires médicaux, les frais pharmaceutiques, les indemnités journalières aux malades et blessés et les pensions.
Un des aspects les plus curieux de l'aventure saint-simonienne est certainement l'intérêt très vif manifesté par ses adeptes, médecins ou non, pour l'homéopathie. Curie, Simon, Jaenger, Verrolot, Fourcade, Rigaud et Cognat s'enthousiasment pour cette nouvelle thérapeutique, au point de l'essayer dans le traitement de la peste et du choléra. C'est, pensent-ils, la médecine de l'avenir, surtout la médecine des prolétaires, simple et peu coûteuse. On retrouve fréquemment dans la correspondance de ces médecins saint-simoniens cette allusion à la valeur sociale de l'homéopathie et, de même que la doctrine de Saint-Simon, elle devient l'objet d'un véritable apostolat à caractère prophétique. On crée un enseignement populaire surtout destiné aux femmes, que l'on estime devoir être, avec leurs enfants, les premières bénéficiaires de cette nouvelle thérapeutique. Lorsque, vers 1840, le saint-simonisme décline en tant que religion, le rôle social du médecin persiste mais en perdant son inspiration religieuse au profit d'une médecine laïque et vraiment scientifique.
Étienne Bailly (1796-1837)
Le noyau des plus anciens fidèles de Saint-Simon s'est donné pour objectifs, après sa mort, de poursuivre le travail doctrinal du maître, de le mettre en ordre et de le faire mieux connaître du public.
Parmi eux figure le docteur Étienne Bailly qui semble avoir eu dans ce programme un rôle assez modeste.
Né à Blois en 1789, il étudie la médecine à Paris et obtient son diplôme en 1817 avec une thèse sur les phlegmasies.
C'est probablement durant ses études qu'il rencontre Saint-Simon auquel Augustin Thierry le présente. Il devient l'ami intime du philosophe, dont il étudie et admire la doctrine.
Mais très tôt il commence à voyager dans le Midi, séjourne à Montpellier, puis à Rome, où il observe les fièvres pernicieuses qui lui fournissent la matière d'un de ses livres : Traité anatomico-pathologique des fièvres intermittentes, simples et pernicieuses, fondé sur les observations cliniques recueillies en Italie et notamment à l'hôpital du St Esprit pendant les années 1820, 1821, et 1822.
De retour en France, il est choisi par le comité grec de Paris pour établir en Grèce un service de santé que le gouvernement provisoire vient de créer et dont il prend la direction. Il se rend à Athènes et dans diverses places de Morée pour y ouvrir des hôpitaux et fournir des secours. Il passe ainsi plusieurs années en Grèce avec son neveu le docteur Blondeau, mais se trouve à Paris lors de la mort de Saint-Simon en mai 1825. C'est lui qui prononce l'éloge funèbre devant sa tombe.
Pour son œuvre humanitaire, ce précurseur des ONG reçoit le titre de citoyen hellénique.
Rentré à Paris, il reprend l'exercice de la médecine et meurt prématurément à quarante et un ans.
Bailly a laissé plusieurs ouvrages philosophico-religieux, dont L'existence de Dieu et la liberté morale démontrée (sic) par des arguments tirés de la doctrine du Dr Gall.
Mais sa foi saint-simonienne avait rapidement faibli après la mort de son maître et ami, avec les successeurs duquel il avait pris ses distances.
Philippe Buchez

Après Bailly qui n'a eu qu'une participation limitée au mouvement, un autre médecin parvient au saint-simonisme après un parcours aventureux, Philippe Buchez (1796-1865). Il est né le 30 mars 1796 à Matagne-la-Petite, village situé à quinze kilomètres de Givet, d'un père employé à l'octroi de Paris acquis aux idées de la Révolution et d'une mère pieuse catholique. En 1811, il entre comme surnuméraire à l'octroi de Paris où il fait la connaissance de Saint-Amand Bazard, futur chef du saint-simonisme. Après la mort de son père il donne en 1815 sa démission de l'octroi et caresse le projet de faire ses études de médecine. Comme beaucoup de futurs médecins à cette époque, il commence par suivre des cours d'histoire naturelle au Jardin des Plantes et travaille sous la direction de Cuvier. Mais ces études sont fréquemment interrompues par son activité politique.
Buchez s'y est en effet engagé de bonne heure et milite avec Bazard dans l'opposition au gouvernement monarchiste, affichant des idées républicaines et franchement matérialistes. C'est l'époque où la jeunesse intellectuelle s'agite, en particulier les étudiants en droit et ceux de Polytechnique. La Faculté de médecine n'est pas en reste et les étudiants responsables de troubles politiques sont exclus. En 1822, on doit fermer la Faculté, qui ne rouvrira que l'année suivante. À partir de 1818, Buchez et Bazard passent à l'action par le canal de la Maçonnerie, qui n'est pas vraiment une force révolutionnaire, mais qu'ils veulent orienter vers l'action violente. Aussi créent-ils une Loge des amis de la Vérité à laquelle se joignent Geoffroy Cavaignac et deux étudiants en médecine, Paul Curie et Ulysse Trélat. L'action la plus sérieuse est la participation des membres de la Loge à l'insurrection du 19 août 1820, fomentée par un groupe d'officiers en demi-solde, qui espèrent pouvoir compter sur la complicité des organisations étudiantes. Mais la police a été informée et les responsables politiques doivent annuler l'ordre du soulèvement. Les étudiants qui ont caché armes et uniformes ne sont pas inquiétés. Mais Bazard et Buchez s'enfuient tout de même en Belgique.
Parce que la loge des Amis de la Vérité ne leur semble pas un bon instrument pour imposer leurs projets révolutionnaires, Buchez et Bazard se tournent vers la charbonnerie, société secrète dont l'objectif est de lutter contre les monarchies absolues. En 1821, Buchez reçoit pour mission d'organiser les ventes (sections locales de carbonari) en Alsace et se joint à nouveau à une conspiration militaire avec le 29e de ligne de Belfort. Une fois encore, le secret est éventé et plusieurs carbonari, dont Buchez, sont arrêtés.
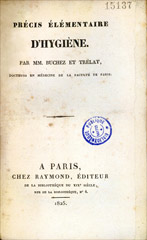
Les inculpés comparaissent devant la cour d'Assise de Colmar le 22 juillet qui prononce plusieurs condamnations à mort. Buchez, qui a pu apporter la preuve qu'il n'était pas présent à Strasbourg au moment des faits, est acquitté. Bientôt la charbonnerie s'éteindra, découragée par ses échecs et ses conflits internes.
Buchez rentre alors à Paris. Dégoûté des complots miliaires, il décide de se consacrer désormais à conquérir l'opinion par des moyens légaux. Il prend (enfin) en avril 1823 ses premières inscriptions à la Faculté de médecine et terminera ses études en 1825. À cette époque, la médecine commence à se transformer, la physiologie progresse grâce à la méthode expérimentale. Buchez lui-même étudie l'anatomie et la physiologie du système nerveux. À peine muni de son diplôme, avec son ami Ulysse Trélat, également médecin, il écrit un Précis élémentaire d'hygiène, marque de son intérêt précoce pour la médecine préventive.
C'est alors qu'il découvre la philosophie de Saint-Simon et lit le Nouveau christianisme qui le porte du matérialisme au spiritualisme. Il est sensible à la promesse d'une science de la société, d'une morale fondée sur la science, et au caractère prophétique de la doctrine. Il y trouve aussi une « famille » soudée par une foi partagée par tous. Il se rapproche alors des premiers disciples du Maître. À la demande d'Olinde Rodrigues et d'Enfantin, il publie dans le journal Le Producteur des articles médicaux où les préoccupations sociales étaient clairement affichées. Buchez est devenu un des chefs d'école du saint-simonisme. Il transmet ses idées dans le Journal du Progrès des Sciences et Institutions médicales et organise avec Bazard des exposés publics de la doctrine. Mais ce ralliement ne dure que peu de temps et une rupture survient lorsqu'est créée la nouvelle Église et que Bazard et Enfantin en deviennent les chefs. Ce schisme n'empêche pas Buchez de se présenter désormais comme le véritable continuateur de Saint-Simon. Défenseur des associations, il inspire à Louis Blanc l'idée des coopératives ouvrières.
Buchez n'a jamais exercé la médecine tout au moins en clientèle, mais il a soigné des malades lors de l'épidémie de choléra de 1832, ce qui lui vaut une médaille de la Ville de Paris. Il fait des leçons orales aux étudiants en médecine et publie en 1838 une Introduction à l'étude des sciences médicales. L'activité politique et sociale l'occupe presque totalement. En 1848, il devient maire-adjoint de Paris et est élu à l'Assemblée constituante dont il sera le président. Mais il échoue aux élections à l'Assemblée législative. Après le 2 décembre, il est emprisonné quelques jours puis se retire de la politique. Il vit alors d'une modeste pension que lui verse un industriel sympathisant à ses idées et continue à publier quelques articles devant la Société médico-psychologique, comme Éléments pathologiques de la folie. Il meurt le 11 août 1865 lors d'un voyage à Rodez.
Laurent Alexis Cerise
Né à Aoste en 1807, devenu docteur en médecine de la faculté de Turin après une thèse sur La variole, et ses indications thérapeutiques, Cerise est autorisé à exercer en France en 1834. Nous ne savons rien sur sa carrière, qui semble s'être déroulée à Paris. La médecine y a probablement tenu peu de place, car il s'est surtout occupé de philosophie. Il est un des fondateurs du journal L'Européen, journal de morale et de politique. À une date indéterminée, Cerise se lie avec Philippe Buchez, le fondateur et l'animateur de L'Européen, qui lui fait découvrir la doctrine de Saint-Simon. Mais son nom n'apparaît pas parmi les propagandistes. À Noël 1829, il suit Buchez dans sa rupture avec l'école saint-simonienne au moment où elle se constitue en « Église ». Il participe avec lui au Journal des progrès des sciences médicales. Il est aussi un des fondateurs des Annales médico-psychologiques, écrit un Exposé et examen critique du système phrénologique (1836) et un ouvrage dont le seul titre évoque les préoccupations des saint-simoniens : Des fonctions et des maladies nerveuses considérées dans leurs rapports avec l'éducation sociale et privée, morale et physique (1842).
(D'après C. Sashaile de la Barre, Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, 1845)
E. Charpin

Bien qu'il soit cité à plusieurs reprises dans le Fonds Enfantin, son nom n'apparaît que tardivement parmi les saint-simoniens. Né vers 1812 (nous ignorons où et la date exacte), médecin, ancien interne de l'hôpital de Grenoble, il fait partie des « compagnons de la femme » que Barrault entraîne à Constantinople. Après cet échec, il gagne l'Égypte, où il cherche à s'employer. Lorsque Clot-Bey propose aux médecins français de les engager comme médecins militaires au barrage sur le delta du Nil à condition qu'ils présentent leur diplôme, Charpin pose problème, car il n'en a pas. Clot-Bey, conciliant, se contentera « d'un petit examen pour lequel il lui suffira de revoir un peu d'anatomie et de chirurgie. » Les choses se passent bien et il est envoyé au barrage.
De retour en France après l'épidémie de peste, Charpin ne semble pas avoir poursuivi ses études de médecine jusqu'au diplôme. Il se lance plutôt dans les affaires et s'établit à Candie pour y créer une sucrerie de betteraves. Il a alors pour maîtresse Clara Charbonnel, fille d'un banquier génois et fidèle saint-simonienne. Mais l'affaire a vite dû mal tourner, puisque, dès 1836, il envisage de partir pour l'Australie fonder avec Barrault une colonie saint-simonienne. Sa situation pécuniaire catastrophique ne lui permet pas de réaliser ce rêve qui aurait probablement été encore un échec. Après avoir quelque temps travaillé dans un organisme de bourse, il sollicite d'Enfantin un poste d'employé à la Caisse des Actionnaires du Canal de Suez, qu'il n'obtient probablement pas, puisque selon certains, on le retrouve médecin du vice-roi d'Égypte en 1883.
Cognat
Dans la troupe entraînée par Émile Barrault à la recherche de la Femme-Messie à Constantinople, figurent quelques médecins, parmi lesquels Cognat. Nous ne savons presque rien de ses origines, sinon qu'il est chirurgien-interne à l'Hôtel-Dieu de Lyon lorsqu'il apparaît dans la famille saint-simonienne et devient en 1832 un des apôtres les plus dynamiques de Lyon qui se situe alors comme le foyer de province le plus important.
Mais les autorités commencent à s'alarmer du programme social, surtout lorsque survient en novembre la révolte des canuts. Cognat est alors arrêté et emprisonné. Après sa libération, il continue à assurer la direction de l'Église de Lyon avec un certain Derrien, fils de soyeux, puis gagne Grenoble pour y continuer son apostolat. Tous deux sont rejoints par Thomas Urbain. Devenu médecin, probablement médecin militaire, Cognat s'enthousiasme pour le projet de Barrault de partir en Orient à la recherche de la « Mère ». Il suit donc les « Compagnons de la Femme », parmi lesquels on retrouve Adolphe Rigaud.
On connaît cette extravagante épopée. Arrivés à Constantinople, les Compagnons abordent les femmes voilées et les saluent en soulevant leurs bonnets. Ils prêchent leur religion avec l'aide d'un drogman qui traduit leurs discours. Cette attitude étonne et choque la population. Elle indispose également l'ambassadeur de France qui cherche à les confiner dans un quartier grec périphérique. Mais quelques jours plus tard, le sultan donne l'ordre de les expulser. Ils sont jetés dans une barque qui les dépose à Smyrne. Dans cette ville très européanisée, ils séjournent plusieurs semaines, poursuivant leur apostolat. Cognat y retrouve des médecins de marine qu'il connaît à bord de vaisseaux français qui font escale dans le port. Les Compagnons de la Femme sont encore à Smyrne lorsque Lamartine y passe revenant de la Terre Sainte, où sa fille vient de mourir. Cognat lui remet quelques brochures saint-simoniennes, dont le recueil Économie politique. Quelques jours plus tard, les ayant lus, le poète lui répond, l'assurant « qu'il approuvait ses nobles désirs d'amélioration sociale », tout en ajoutant qu'il ne partageait pas son illusion de réaliser un âge d'or ici-bas.
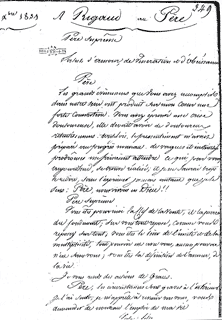
Surmontant leur désillusion, les membres du groupe se séparent alors, la plupart pour aller avec Barrault rejoindre Enfantin en Égypte. Cognat, qui, comme Rigaud, ne supporte plus l'autoritarisme du chef, forme le projet d'aller en Terre Sainte probablement plus dans un but de tourisme que de quête mystique — ce dont il était bien revenu — et gagne Beyrouth. Là, rejoint par Thomas Urbain, l'envie le prend de rendre visite à Lady Esther Stanhope, chez qui Lamartine vient de passe peu de temps avant. La belle et fortunée nièce de William Pitt, après une vie riche en aventures, finit sa vie dans les montagnes du Liban. Elle reçoit les visiteurs et partage avec eux de longs entretiens philosophico-mystiques. Elle croit fermement à l'occultisme, à l'astrologie et attend le Messie d'une nouvelle religion. Mais nos trois Compagnons ne réussissent pas à la convaincre que cette religion à venir est justement la leur. Ils restent dix jours, pendant lesquels Cognat donne des soins dans les villages druzes du voisinage. Elle leur déconseille de se rendre à Jérusalem, dont la route n'était pas sûre, mais leur prête des chevaux pour aller visiter Baalbek. Enfin, ils se décident à rejoindre leurs coreligionnaires à Alexandrie puis au Caire.
Mais les médecins saint-simoniens nouvellement débarqués se trouvent sans emploi. Aucun n'est engagé pour enseigner à l'École de médecine. Certains ouvrent alors un cabinet, Cognat y fait de la « médecine magnétique » Le projet du canal de Suez ne décolle pas, Mohamed Ali considérant comme prioritaire la construction d'un barrage sur le delta du Nil. Le chantier est commencé avec une foule de travailleurs, ce qui nécessite un service médical. Cognat et quelques autres saint-simoniens, Verrolot, Jallat, Drouot et Charpin y sont engagés, mais à titre de médecins militaires relevant du service de santé égyptien et à condition de fournir leur diplôme. La vie sur le chantier du barrage est difficile, car les vivres sont rares, et il faut en faire venir du Caire, alors que l'argent manque. La paie de 100 piastres par mois, versée irrégulièrement, leur suffit à peine et ils vivent à crédit. Démoralisés, certains, comme Drouot et Jallat, repartent pour la France. Cognat reste, et lorsqu'éclate la peste au Caire, il fait face, avec les faibles moyens dont il dispose, au fléau qui tuera une douzaine de ses coreligionnaires.
La peste finie, Cognat demeure comme médecin militaire en Égypte. Le vice-roi l'envoie en octobre 1835 servir dans le Hedjaz à Djedda, près de La Mecque, où il retrouve Lachaize, qui accompagne Soliman Pacha, et le rejoint. Il s'ennuie, s'adonne à la littérature, écrivant des drames et des romans qui ne sont pas passés à la postérité. Il compose aussi les paroles de quelques chansons, comme Le Bédouin, mises en musique par Félicien David, compositeur saint-simonien qui a participé avec lui à l'aventure des Compagnons de la femme à Constantinople. Puis il tombe gravement malade et, en octobre 1836, revient à Alexandrie, où il est hospitalisé. Des troubles intestinaux, des douleurs hépatiques évoquent un probable abcès amibien du foie. Mais il en guérit probablement puisque, abandonnant la médecine, il serait devenu inspecteur des poids et mesures en Égypte.
Hippolyte Combes (1809-1873)
Sur ce médecin, nos informations sont succinctes. Né à Castres, il a été élevé, comme Ribes, au collège de Sorèze, et fait aussi des études de médecine, probablement à Montpellier. Ribes dirige sa thèse en 1832, « Étude sur la vivisection », qui vise essentiellement à démontrer que cette pratique heuristique ne confirme nullement le dogme organiciste. Il devient professeur d'hygiène à l'École de médecine de Toulouse et publie plusieurs ouvrages : Cours d'Hygiène et de médecine légale, (1841) ; De la médecine en France et en Italie, administration, et doctrines, pratiques ; et Quelles meilleures bases d'une classification des maladies ? (1839).
Paul Curie (1799-1863)
Paul Curie, qui sera plus tard le grand-père de Pierre Curie, le célèbre physicien, nous offre le portrait d'un ardent et courageux militant. Né à Montbéliard en 1799, il fait ses études médicales à Paris et soutient sa thèse en 1824. C'est probablement durant ses études qu'il entre en contact avec le saint-simonisme par la doctrine duquel il est rapidement conquis. Mais dès 1820, on le trouve affilié à la fameuse loge des Amis de la vérité, où militent Buchez et Bazard. Il ne tarde pas à se marier en épousant Augustine Hofer, fille d'un riche fabricant d'indiennes de confession protestante. Esprit religieux, Curie appartient aussi à la religion réformée et siège depuis 1829 au Consistoire, dont il devient bientôt secrétaire. Mais, rapidement, ses idées sociales et religieuses inquiètent le Consistoire. Conformément à la doctrine saint-simonienne, Curie en effet professe que religion et politique ne sont qu'une seule et même chose ; que la religion chrétienne n'est plus en harmonie avec les besoins du sentiment et de la raison. Les saint-simoniens ne sont pas hostiles au christianisme, soutient-il, mais ils sont plus avancés, car ils veulent réaliser la morale évangélique. « Nous pouvons déjà sur cette terre (réaliser) ce que le christianisme n'a fait que demander pour l'autre Vie. » Ses conceptions ne sont évidemment pas du goût des autorités religieuses qui mènent campagne contre lui et l'excluent du Consistoire.
Sur le plan social, il dénonce la condition ouvrière, particulièrement le travail des femmes et des enfants dans les manufactures. Pour les aider, il crée un enseignement, organise des débats, ouvre une école de musique et projette de créer une école industrielle. Les pouvoirs publics s'en montrent inquiets. Le sous-préfet d'Altkirch écrit au maire de Mulhouse : « L'Association universelle prêchée par les Saint-Simoniens pourrait paraître à des ouvriers le synonyme de propriété commune et les conduire à exiger une réparation violente du tort qu'ils considéreraient comme leur étant fait, à eux qui possèdent peu, par rapport à ceux qui sont propriétaires de riches établissements ». Devant l'affluence des personnes qui assiègent la maison de Curie, la mairie se résout alors à interdire les réunions publiques. Pourtant, il continue à jouer un rôle dans la vie de la cité mulhousienne, proposant la création de comités de salubrité et l'institution de médecins cantonaux.
Autant que de l'opposition religieuse, Curie s'inquiète de l'influence de la propagande fouriériste qui, en Alsace, relaie le saint-simonisme après son interdiction. Un confrère de Colmar, le docteur Jaenger, passé par le saint-simonisme, y était déjà converti. Mais une autre conversion va survenir chez Curie. En janvier 1832, il fait à Mulhouse la connaissance de son confrère Léon Simon, saint-simonien comme lui et qui, dans le temps libre que lui laisse la prédication de la doctrine, exerce sa profession de médecin et a été conquis par le nouveau système de Hahnemann. Jaenger, de Colmar lui aussi, est devenu un adepte du médecin saxon. Ce sont là les premières manifestations d'une curieuse inclination du saint-simonisme pour l'homéopathie. Curie décide alors de quitter Mulhouse et d'aller à Paris pour s'instruire de la méthode de Hahnemann. Arrivé dans la capitale en septembre 1833, il y retrouve Simon. Tous deux travaillent ensemble et se montrent aussi ardents homéopathes que fidèles saint-simoniens. En 1838, Curie va s'installer à Londres, où il fait une belle carrière, mais quelques années plus tard, il est frappé par une maladie chronique. Il meurt en 1863.
Charles Dussap
Bien qu'il ait été un converti tardif, Charles Dussap mérite de figurer parmi les médecins saint-simoniens, surtout en raison du dévouement qu'il a montré envers eux lors de la peste. Il était venu en Égypte avec l'expédition de Bonaparte comme chirurgien de 2e classe, mais, de retour en France, il a la nostalgie de la vie en Orient et revient s'installer à Constantinople comme médecin, puis s'établit en Égypte. Sa réputation médicale excellente lui vaut la considération de Méhémet-Ali, qui lui octroie en 1821 un grade élevé dans l'armée. Il est missionné pour aller en Haute-Égypte vacciner contre la variole les nouvelles recrues noires venues du Senaar et du Kordofan. Mais Dussap donne sa démission de l'armée en 1825 pour commencer une carrière civile au Caire. Le médecin français Barthélemy Clot, dit Clot-Bey, devenu un personnage influent auprès du vice-roi, a de l'estime pour lui et le fait nommer membre du premier jury d'examen à l'École de médecine. Dussap avait pris pour femme une esclave éthiopienne, Halima, dont il a deux enfants, Hanem et Arif. Hanem est instruite par son père à donner des soins infirmiers. Lorsque les saint-simoniens arrivent, Dussap les aide financièrement. Il en héberge plusieurs au moment où la peste éclate, en décembre 1834. C'est à leur contact qu'il est gagné par la doctrine.
Dussap se dépense sans compter pendant cette épidémie qui dure quatre mois. Il visite les malades aussi bien européens qu'indigènes et, chez ces derniers, son âge et sa grande barbe blanche de patriarche le font accepter dans les harems. Partout, il s'assied à leur côté sans prendre aucune précaution. Revenu chez lui, comme ses hôtes s'en inquiètent, il les rassure : « N'ayez crainte [...] la peste sait que nous sommes invulnérables ; elle a peur de moi. C'est la douzième fois que nous nous trouvons en présence, soit ici, soit à Constantinople et j'en ai toujours été vainqueur ». Comme beaucoup de ses confrères, il ne croit pas à la contagion. Pourtant, bientôt sa femme Halima et sa fille Hanem contractent une forme mortelle. Au zénith de l'épidémie, il est frappé à son tour et en meurt le 3 mai 1835. De lui, Clot Bey écrit en guise d'épitaphe : « Ce digne homme est mort dans le milieu de l'épidémie. S'il a peu fait pour la science, il a laissé au monde l'exemple d'une abnégation rare et d'un courage à toute épreuve. »
Joseph (ou Charles) Fourcade
En décembre 1834, débarquent à Alexandrie plusieurs médecins militaires venus se joindre à leurs camarades saint-simoniens. Parmi eux, Fourcade, converti à la doctrine depuis une date indéterminée, et qui est en garnison à Troyes, brûle d'envie de se joindre à l'expédition d'Enfantin, mais n'ose pas demander une permission d'un an à son capitaine, car il craint l'hostilité de sa hiérarchie à l'égard des saint-simoniens. Enfin, il s'y résout en invoquant pour prétexte des études scientifiques et part en juin, laissant à Troyes une fiancée.
D'abord attaché à l'hôpital de l'Esbékié, du Caire, il est nommé médecin-chef de l'hôpital militaire d'Alexandrie. Il s'en réjouit, car la peste vient d'éclater dans ce port : il pense qu'elle est heureusement très limitée et qu'« elle lui donnera l'opportunité de pouvoir étudier de près cette maladie sur laquelle on a tant écrit ». Mais ayant fait, avant de quitter Le Caire pour rejoindre son nouveau poste, l'autopsie d'un pestiféré, il contracte la maladie et meurt après trois jours d'agonie le 20 février 1835.
Franz Joseph Gall (1758-1828)
Médecin de Saint-Simon, Gall, bien que nous ne connaissions pas son opinion sur la doctrine du Maître, mérite d'être cité ici en raison de l'influence qu'il a eue sur certains de ses disciples médecins.
Né d'un père d'origine italienne, il fait ses études de médecine à la faculté de Strasbourg et les poursuit à Vienne où il obtient son doctorat en 1785. Anatomiste distingué, il étudie surtout le système nerveux et découvre le premier que le cerveau est fait d'une matière grise qui contient des corps cellulaires et d'une matière blanche constituée des prolongements ou axones de ces cellules. Alors que beaucoup de ses confrères considèrent que le cerveau, organe de la pensée fonctionne comme un tout, Gall soutient au contraire — évidemment sans preuve — qu'il existe des zones ou localisations qui répondent à différentes facultés. Il en dénombre environ vingt-sept, comme l'amour de sa progéniture, le penchant au vol, la piété… De façon curieuse, il établit une relation entre ces localisations et les bosses du crâne qui en seraient les manifestations extérieures. Il suffit donc de repérer ces bosses pour faire une analyse des facultés de l'individu. Cette méthode dénommée « phrénologie », qui dépasse évidemment les données de la science de l'époque le fait considérer comme un charlatan, mais il trouve des défenseurs comme Stendhal, Metternich et Saint-Simon, dont il fait l'autopsie à sa mort, en 1825. Il découvre un cerveau de grande taille et parcouru d'innombrables circonvolutions où il voit la trace du génie.
Précurseur des localisations cérébrales que les travaux ultérieurs confirmeront, il fut déconsidéré en raison des conséquences pratiques qu'il crut pouvoir en tirer.
Ange Guépin (1805-1873)

Figure marquante du saint-simonisme dans l'Ouest, Ange Guépin est né à Pontivy, en 1805, d'un père républicain qui marqua son fils de son empreinte. Monté à Paris après le baccalauréat, il y fréquente la Chabonnerie et suit le cours de philosophie de Théodore Jouffroy tout en s'inscrivant à la faculté de médecine de Paris, où il est reçu docteur en août 1828. On le trouve en juillet 1830 dans un groupe d'insurgés nantais. Il continue cependant à hanter les réunions saint-simoniennes de l'hôtel de Gesvre. Son intérêt pour la doctrine n'est pas sans rapport avec le caractère scientifique et social de celle-ci, comme le prouvent les deux épigraphes qui figurent en tête de sa Philosophie du socialisme : « in scientia spes », et « aux plus déshérités, le plus d'amour » — du pur Saint-Simon.
Mais Guépin n'a jamais été un adepte de stricte observance, car il reste attaché aux valeurs républicaines, à la liberté et à l'égalité. De même, la dérive religieuse d'Enfantin, ses élucubrations sur le « couple prêtre » et son sensualisme le rebutent. Il a aussi trop de bon sens pour participer aux extravagances qui se dérouleront dans la retraite de Ménilmontant. Pour lui, « en religion, en science, en industrie, la doctrine n'était (devenue) qu'un communisme théocratique dirigé par une hiérarchie sans contrôle ». Il garde pourtant une certaine sympathie pour Enfantin avec qui il correspond longtemps. Médecin ophtalmologiste apprécié, il arrive à concilier sa profession avec une activité politique et sociale et nombre d'autres activités : banques régionales, crédit à long terme, liberté du commerce, où se retrouvent beaucoup d'idées issues de la doctrine, mais aussi du socialisme.
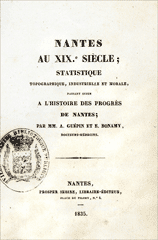

Il crée à Nantes la première école professionnelle pour filles. Il faut ajouter à ce programme de nombreuses publications, dont un Traité d'Économie sociale (1843) et, avec son ami Bonamy, autre médecin saint-simonien de Nantes, un ouvrage sur Nantes au XIXe siècle : statistiques, topographie industrielle et morale (1835). Le lien qu'il établit entre l'industrie et la morale est typiquement saint-simonien.
La révolution de 1848 fait de Guépin un préfet de la Loire-inférieure, puis du Morbihan, mais le succès de Louis Napoléon Bonaparte entraîne sa destitution. Après le 2 décembre, il est privé de ses cours à l'École de médecine et même incarcéré pendant quelque temps. Après la chute de l'Empire, le Gouvernement provisoire le nomme à nouveau préfet de la Loire-inférieure. Il meurt en mai 1873 et son convoi funèbre est suivi par des milliers de personnes.
Fleury Imbert (1796-1851)

De la région lyonnaise, nous retiendrons aussi le professeur Fleury Imbert. Nous savons peu de choses de ses origines, sinon qu'ayant commencé ses études de médecine à Lyon, il est expulsé des hôpitaux de cette ville pour désobéissance à son maître Janson. Le motif a dû être grave, puisqu'il est empêché de passer sa thèse en 1817. Un autre de ses patrons, Villard, lui conseille de continuer ses études à Paris, ce qu'il fait. Il y reçoit l'appui de Cuvier et de Royer-Collard et peut enfin soutenir sa thèse le 23 août 1819. C'est probablement durant ces années parisiennes qu'il a connaissance des idées de Saint-Simon. Il revient alors à Lyon, où grâce à la protection du doyen Le Roux, sa carrière médicale reprend un cours normal et même flatteur, puisqu'il devient chirurgien à l'hôpital de la Charité, professeur à la faculté et membre titulaire de la Société de médecine de Lyon.
Bien que chirurgien, il ne craint pas de s'aventurer hors de sa discipline, lorsqu'il publie en 1825 un Prodrome d'une nouvelle doctrine médicale, où l'on reconnaît l'influence de Franz Joseph Gall, médecin allemand, neuro-anatomiste, précurseur des localisations cérébrales et père de la phrénologie. En effet, pour Imbert, « tous les phénomènes de l'économie animale se rapportent en dernière analyse au système nerveux qui est le moteur unique de l'organisme ». Comme Gall, il affirme que le cerveau est l'organe des facultés ou plutôt des fonctions intellectuelles, morales et instinctives qui sont liées à une localisation précise. On peut ainsi localiser le siège de l'amour physique, celui de l'amitié, de l'esprit métaphysique, de la tendance au meurtre. Gall prétendait aussi reconnaître ces facultés chez chaque individu grâce au développement des bosses crâniennes correspondant aux localisations cérébrales. Cette théorie sera nommée par un de ses disciples la phrénologie (étym. « la science de l'esprit »). Mais Imbert va plus loin. Il attribue à la moelle épinière un rôle essentiel dans diverses fonctions, outre la motricité et la sensibilité déjà connues, par exemple la respiration, l'hématose, les sécrétions, la génération. Quant au cervelet, il est « chargé des idées relatives à la vie de l'espèce ». Il s'ensuit que c'est dans le centre cérébro-spinal qu'il faut placer le siège de toutes les maladies. Une métrite est une affection de la partie inférieure de la moelle ; une tumeur utérine est une affection du cervelet. Mais, précise Gall, « la recherche de la cause qui [dans la maladie] anime le système cérébro-spinal est inutile au médecin. C'est une question de métaphysique et non de physiologie ». La thérapeutique ne doit donc utiliser que des « corps » qui agissent sur la portion de l'axe cérébro-spinal qui est malade. Est-ce pour mieux servir la théorie de Gall, qu'après la mort de celui-ci, Imbert épousa sa veuve ? Dans ses cours, il ne consacre en effet pas moins de trente leçons à la défense des travaux de ce dernier sur sa théorie des localisations cérébrales et son corollaire, la phrénologie. Enfin, en 1826, le sujet de son enseignement porte sur le magnétisme. Il était donc de ceux qui poursuivaient encore des chimères.
Outre son intérêt pour Gall, qui gravita autour de Saint-Simon, Imbert est en 1832 signalé comme un zélé partisan des idées saint-simoniennes. Il paraît avoir ensuite évolué vers le fouriérisme, puisqu'on le retrouve en 1847 auteur d'une brochure sur les crèches et sur l'allaitement maternel que publie la Librairie phalanstérienne.
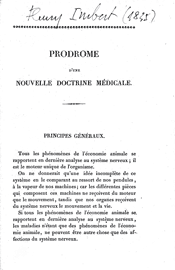
Jallat (1792- ?)
On ignore à peu près tout du passé de Jallat. Où et quand a-t-il fait ses études de médecine ? À quelle date survient sa conversion au saint-simonisme ? On sait seulement que durant les journées de juillet 1830, il panse au domicile de Bazard des blessés des émeutes. Il œuvre pour prêcher la doctrine dans le milieu ouvrier des 1er et 2e arrondissements de Paris, ce qui lui vaut d'accéder au deuxième degré de la hiérarchie. Mais ses idées tendent à le rapprocher du groupe de Buchez qui a fait sécession. Aussi, en février 1832, après le départ d'Olinde Rodrigues et de Bazard, Enfantin l'appelle-t-il au Collège, avec Simon et Rigaud, pour tenter de le détourner de Buchez. S'il participe bien à la retraite de Ménilmontant, il la quitte dès le 22 mai, ne pouvant s'adapter à la continence et à une discipline aussi dure que celle d'un couvent. Dans une lettre à Enfantin précédant son départ, il se plaint d'avoir d'y avoir été mal considéré.
Il est vrai qu'auprès de ses camarades, il passe pour orgueilleux et vindicatif. Il a souvent des conflits avec ses pairs, mais en général tout se finit par une embrassade, avec une débauche de sentiment, comme c'est l'habitude dans la Famille saint-simonienne. D'Eichthal apprécie pourtant ses qualités d'apôtre : « Jallat est autre chose qu'un médecin, il est un homme d'action, d'industrie, il est un laboureur infatigable, plein de résolution et de courage. »
Jallat rejoint le groupe d'Enfantin en Égypte en décembre 1834. Il est affecté au chantier du barrage, mais il semble n'y être resté que quelques semaines. Il serait retourné à Paris pour exercer la médecine, bien que, selon Charléty, son retour ait eu lieu en 1845 seulement. On perd ensuite sa trace.
Émile Küss (1813-1871)
Émile Küss naît à Strasbourg dans une famille de petite bourgeoisie protestante qui compte un oncle pasteur. Il entre à l'école de médecine de cette ville en 1833, devient interne des hospices civils en 1835. Puis, quittant Strasbourg, il va travailler à Paris chez Breschet en anatomie et revient dans sa ville natale en 1836. Il découvre les travaux allemands, principalement ceux de Theodor Schwann qui, avec sa théorie cellulaire, ouvre la porte à la connaissance de la structure élémentaire du vivant. Il commence alors lui-même des recherches microscopiques, enseigne la physiologie et devient chef de service hospitalier.
Mais Küss se consacre aussi à la politique. Rallié aux idées républicaines, il regroupe autour de lui un cercle de jeunes sympathisants. En 1848, il est devenu le chef du parti radical à Strasbourg et prend une part importante à la vie publique locale, d'abord comme conseiller municipal, puis comme conseiller général. Après l'élection de Louis Napoléon Bonaparte, il fonde un journal bilingue Le Démocrate du Rhin. Le 11 juin 1849, il manifeste contre le prince-président, qu'il accuse de ne pas respecter la constitution. Il est arrêté, paraît devant la Cour d'assise de Metz pour attentat contre la sûreté de l'État et le gouvernement établi et pour excitation à la guerre civile. Mais il est acquitté et relâché en octobre 1849. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il se démet de ses fonctions publiques et se consacre à sa profession. On veut lui attribuer la Légion d'honneur, qu'il refuse. Il se consacre à l'œuvre de l'instruction populaire et fonde des bibliothèques populaires.
En juin 1851, il se sépare du Démocrate du Rhin, devenu à ses yeux trop socialiste. À nouveau conseiller municipal, il est élu maire le 14 septembre 1870 lors de la proclamation de la République. Après la capitulation, il reste en place pour assurer l'ordre et remettre en état la ville bombardée. Le 8 février 1871, le gouvernement provisoire réfugié à Bordeaux fait élire une nouvelle Assemblée nationale. Küss est élu député du Bas-Rhin, mais il meurt à Bordeaux le 1er mars.
Sa biographie ne contient aucune allusion à une éventuelle appartenance au saint-simonisme. Pourtant, dans une lettre à Michel Chevalier non datée (Bibliothèque de l'Arsenal, F. E., ms. 6704/57), il lui annonce qu'il quitte Wissembourg pour Colmar afin de s'unir au groupe saint-simonien qui s'y est établi. « Tous les jours, ajoute-t-il, je sens mes propres sympathies s'augmenter par l'influence de cet immense amour que vous étendez sur l'humanité. » Son passage dut être bref, car un peu plus tard, il devient fouriériste.
Charles Pellarin (1804-1883)
Charles Pellarin, jeune médecin de marine de Brest, est gagné à la doctrine sous l'influence des prédications d'Adolphe Rigaud, de Paulin Talabot et de Louis Rousseau, en Bretagne, vers 1830. Il prend alors contact avec Enfantin et, à la demande de celui-ci, écrit dans Le Globe quelques articles sur la situation des travailleurs de l'agriculture en Bretagne. En mai 1832, le Père l'invite à participer à la retraite de Ménilmontant. Malgré l'opposition de sa famille, il donne sa démission au Conseil de santé, vend une partie de ses biens et arrive sur place. Il est affecté au balayage des couloirs, puis, comme la poussière lui provoque des crises d'asthme, on le transfère au soin du luminaire. Il participe à toutes les activités du groupe. Mais il se lasse vite de cette discipline de collège qui, aux repas, impose aux apôtres d'attendre que le Père soit assis avant de s'asseoir eux-mêmes et de manger. Pellarin est également choqué de devoir, sous la pression de Talabot, faire abandon à la communauté de sa montre, un souvenir de famille. Il commence à être gagné par le doute. Il ne voit pas comment ces cérémonies, ces chants, ces travaux de jardin, peuvent contribuer à « améliorer le sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre ». Il écrira plus tard : « J'aperçois maintenant clairement la fausseté de la marche suivie par le saint-simonisme qui tournait le dos à l'association en prétendant nous y conduire, qui étouffait tous les sentiments naturels sous une hiérarchie sacerdotale monstrueuse et absorbait l'humanité dans un homme et dans un couple. » Le 22 mai, il quitte Ménilmontant avec Rigaud, Simon et Jallat.
Pellarin ne prend pas part à l'expédition d'Égypte, mais sa situation devient critique car, ayant donné sa démission de la marine, il se trouve sans emploi et sans le sou sur les pavés de Paris. Il pense en arriver au suicide. Enfin, il reprend ses études de médecine et suit les cours d'accouchement de Hatin. Nous ignorons s'il exerce la médecine, car on perd malheureusement sa trace. On sait seulement qu'après avoir rompu avec le saint-simonisme, il donne son adhésion à la doctrine de Charles Fourier, dont le Traité d'association domestique agricole, qu'il a trouvé et lu à Ménilmontant, a produit sur lui un grand effet : « J'apercevais clairement la fausseté de la marche suivie par le saint-simonisme qui tournait le dos à l'association en prétendant nous y conduire, qui étouffait tous les sentiments naturels sous une hiérarchie sacerdotale monstrueuse et absorbait l'humanité dans un homme et dans un couple. »
Devenu un ardent propagateur du fouriérisme, Pellarin est l'auteur, notamment, d'une biographie de Fourier parue en 1843, augmentée et rééditée en 1871.
Il mourut en 1883.
Nicolas Perron (? -1876)
Nicolas Perron, dont nous ne connaissons pas la date de naissance, est un pupille de l'Assistance publique. On ne sait comment il réussit à faire des études médicales à Paris ni comment il en vient à s'intéresser à la doctrine de Saint-Simon, mais son penchant pour les thèses particulières de Buchez autorise l'hypothèse de son appartenance au cercle des amis de ce dernier, médecin lui aussi. Compromis dans quelque conspiration républicaine, Perron choisit de se soustraire aux poursuites en quittant la France pour Le Caire, où on le retrouve en 1828. Clot bey, qui l'apprécie, le décrit comme « bon observateur, doué d'un jugement excellent et d'un esprit philosophique ». Il l'introduit à l'École de médecine. Perron devient ainsi le seul médecin saint-simonien à enseigner dans cette École. À partir de 1834, Clot bey l'invite à en partager la direction avec lui et quelques années plus tard, le nomme seul directeur. Perron gardera ce poste jusqu'en 1850.
La première difficulté qu'il rencontre est le barrage de la langue. Très peu de professeurs indigènes et encore moins d'étudiants parlent le français, et il est difficile de trouver en arabe une équivalence des termes médicaux modernes. Devenu un arabisant accompli (il parle aussi le cairote populaire et les dialectes berbères ), Perron recherche dans le dictionnaire arabe les termes de médecine les plus proches et traduit en arabe bon nombre d'ouvrages français avec la collaboration d'un lettré musulman, le cheik Mohamed ibn Omar el Tounsy. En 1840, il fonde la Société égyptienne. Il consacre ses loisirs à publier des articles d'histoire préislamique et une traduction française des six volumes du Traité de jurisprudence musulmane de Sidi Khalil ibn Ish'ak. Après un court séjour en France, Perron revient au Caire avec le titre de conseiller. Anticontagioniste impénitent il se bat jusqu'au bout pour réclamer la suppression de la quarantaine en Égypte, à l'instar de l'Empire ottoman. Enfin, en 1854, pour des raisons de santé, il quitte définitivement l'Égypte pour s'installer à Alger. Il cherche à y créer un collège franco-musulman, dans lequel l'enseignement serait basé sur les principes saint-simoniens. Mais les autorités françaises n'y accordent que peu d'intérêt. Il conserve jusqu'en 1859 des relations « respectueuses » avec Enfantin qu'il continue à appeler « Père » dans ses nombreuses lettres (voir par ex. à l'Arsenal, la cote F. E., ms. 7770/107).
Perron meurt à Alger en 1876.
Une grande partie de ses manuscrits est actuellement conservée à la bibliothèque de l'University Collège de Londres.
François Ribes (1798-1864)

Parmi les « apôtres » du Midi, François Ribes mérite une place à part à cause de sa longue fidélité à la doctrine, mais aussi de sa personnalité tourmentée. Son père était médecin à Trouillas près de Perpignan, d'opinion libérale. À onze ans, François est mis en pension dans le Tarn, au collège renommé de Sorèze, une ancienne abbaye dominicaine qui dispense un enseignement d'avant-garde, marqué d'un esprit républicain. Ribes y rencontre nombre de futurs saint-simoniens. Puis il s'inscrit en médecine à Montpellier et passe en 1824 sa thèse intitulée Quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. En 1828, il obtient un congé de six mois pour se rendre à Paris, sous le prétexte de suivre une formation complémentaire, mais il privilégie des cours de philosophie en Sorbonne. C'est là que d'anciens condisciples de Sorèze, ingénieurs, militaires, avocats ou médecins, lui font connaître le saint-simonisme. C'est là aussi qu'il fait la connaissance de Prosper Enfantin, qui devait exercer sur lui une grande influence. Conquis, il adhère et se lance dans l'apostolat.
De retour à Montpellier, Ribes se présente en 1828 au concours d'agrégation, où il est reçu dans la section médecine. Ultérieurement, il héritera de la chaire d'hygiène. En décembre 1847, il est élevé au décanat, mais en est révoqué l'année suivante (en raison de ses idées ?). C'est un camouflet, et il ne reposera jamais sa candidature par la suite. Ses cours sont un mélange de médecine et de philosophie saint-simonienne que les étudiants semblaient apprécier, d'autant plus qu'il a un incontestable talent oratoire. Il est plus gêné avec les adultes, quand il doit leur exposer des théories aussi subversives que la libération de la femme et la suppression de l'héritage. Bientôt, le bruit s'en répand et des plaintes sont déposées auprès des autorités qui commencent à s'inquiéter. Le 4 février 1832, Casimir Perier, ministre de l'Intérieur, demande au préfet de l'Hérault des informations sur « le sieur Ribes, professeur de la faculté de médecine de cette ville [...] qu'on suppose être un carliste exalté. » Le préfet le rassure : « Il appartient à une famille connue pour son libéralisme. Son père a été acquéreur de biens nationaux. Il est certes saint-simonien, mais M. Ribes [se comporte] comme tous les autres saint-simoniens de Montpellier, appartenant à des familles honorablement connues, [et qui] n'annoncent en aucune manière leur intention de troubler l'ordre social ». Mais Ribes sent le danger et se couvre quelques semaines plus tard par une lettre adressée au Courrier du Midi, dont l'ambiguïté ne trompa personne : « Nous croyons nécessaire d'avertir le public que nous nous sommes séparés de la hiérarchie St simonienne, qui a pour chef le Père Enfantin. En cela, nous ne prétendons pas JUGER les nouvelles théories, blâmer ou critiquer en aucune façon des hommes que nous n'avons pas cessé d'aimer et d'estimer. Nous nous bornons à déclarer que nous ne pouvons suivre, en entier, le mouvement actuel de la doctrine saint-simonienne, dont le Globe est l'organe, et assumer la responsabilité des actes ».
En réalité, Ribes ne rompra jamais avec Enfantin, pour lequel il a une vénération qui confine à l'idolâtrie. Il lui écrit souvent et l'aide dans une phase impécunieuse après son retour d'Égypte en lui versant la moitié de son traitement de professeur. Pourtant, lorsqu'en décembre 1836, Enfantin lui annonce son arrivée prochaine à Montpellier, il est inquiet. Quelle impression va faire le Père, surtout s'il vient vêtu de son ridicule habit saint-simonien ? Il voudrait que cette visite passe inaperçue et lui donne ce conseil : « reprenez vos habits bourgeois si disgracieux qu'ils soient [...] faisons en sorte qu'on ne sache qu'insensiblement que vous êtes parmi nous. Le Peuple surtout doit en être instruit le plus tard possible ». Quant à sa vie professionnelle,elle se résume à l'enseignement, car la clientèle privée lui est interdite, dit-il, comme célibataire et comme saint-simonien.
À trente quatre ans, Ribes épouse une femme de la haute bourgeoisie montpelliéraine où ses idées ne devaient guère avoir cours. Il a peu de relations avec cette bourgeoisie qui n'est préoccupée que de l'argent et se plaint du désert dans lequel il vit. Même sa profession le laisse insatisfait : « la médecine a été pour moi une impasse. Je ne puis plus espérer en sortir ». La vie politique ne lui apporte pas de compensation. En 1839, il songe à se présenter à la députation, mais il se désiste à la veille des élections, comprenant que ses idées dérangeantes lui ôtent toute chance de succès. « Il faut bien se garder, lorsqu'on est propriétaire, de dire qu'on s'intéresse au sort de ceux qui travaillent, on a l'air d'un faux frère », écrit-il à Enfantin.
Parmi les nombreuses publications de Ribes, il faut citer un Traité d'Hygiène thérapeutique (1860) et le Discours sur la vie universelle (1833). Mais c'est surtout le Discours sur l'organisation de l'enseignement et de la pratique de la médecine (1838), qui est sans doute la plus originale. Ribes y déplore l'insuffisante préparation scientifique des jeunes qui s'inscrivent à la faculté de médecine. Il propose de leur donner en faculté des sciences un enseignement préliminaire d'histoire naturelle, de physique, de chimie, de botanique et de physiologie, ce qui inclut évidemment pour lui la « physiologie sociale ». Entrés en médecine, les étudiants vivront dans un quartier réservé (une sorte de campus) en communauté avec leurs professeurs, tous associés par des liens étroits qui sont la condition nécessaire du perfectionnement. « Les professeurs eux-mêmes, prédit Ribes, constitueront une véritable association (mot magique pour les saint-simoniens) et une confraternité qui ne sera plus fictive ».
La partie la plus révolutionnaire de l'ouvrage concerne la pratique médicale, car l'auteur est un chaud partisan d'un « service médical régulier », qui n'est autre qu'une médecine étatisée. Il propose que l'on divise la France en « circonscriptions médicales » qui embrasseront une ou plusieurs communes. Il y aurait ainsi des médecins communaux, d'autres de chefs-lieux de canton, d'autres de chefs-lieux d'arrondissement. Ils seront nommés par les pouvoirs publics suivant les besoins. Les facultés de médecine ne produiront annuellement que le nombre de docteurs nécessaire aux diverses localités — on reconnaît la notion saint-simonienne d'harmonie entre la production et la consommation, déjà appliquée à l'industrie. La rétribution des médecins devra cesser d'être individuelle ou provenir des malades ; elle devra être sociale. C'est le seul moyen de sortir du principe de concurrence. L'État pourra financer cette charge des dépenses médicales et sociales tout simplement par la création d'un impôt médical qui pourrait, comme la cote mobilière, être proportionnel à l'état de fortune ou au nombre des membres de la famille. Ce projet sera repris par quelques participants au 1er Congrès de la médecine à Paris en 1845, mais sans succès.
En 1836, Ribes publie des cours et une brochure, Discours sur la vie de la femme, dans la droite ligne de la doctrine enfantinienne. Il établit une analogie entre l'oppression du peuple par les classes supérieures et celle de la femme par l'homme. Mais ces idées, qui devaient paraître audacieuses à ses contemporains, méritent d'être tempérées, car il partage encore beaucoup de préjugés de son temps. Pour lui, la femme est un être fragile, semblable à l'enfant, dotée d'une infériorité intellectuelle constitutionnelle par rapport à l'homme. Il exclut qu'elle puisse jamais occuper des postes de responsabilité. Guépin, qui, vers la même époque, crée une école professionnelle pour les femmes, a une longueur d'avance sur Ribes.
Gravement malade à la fin de sa vie, Ribes se retire à Perpignan où il meurt le 20 février 1864. Ce singulier personnage avait été considéré par ses collègues comme un rêveur, un utopiste, plus qu'un dangereux révolutionnaire. Peu après sa mort, son collègue Bouisson écrivait ainsi dans un « Adieu au professeur Ribes » : « L'imagination du professeur, entraînée (en 1830) par les vives images qui miroitaient à l'horizon de la pensée, devient la proie des idées nouvelles [....] il fait plus, il les prêche dans sa chaire. Il devient à Montpellier le propagateur des idées de Saint-Simon. L'éclectique de la veille est devenu l'exalté du lendemain. »
Léon Simon (1798-1867)
Né à Blois le 27 novembre 1798, Léon Simon a été reçu docteur en médecine en 1822. Il devient en 1826 membre de la Société de médecine pratique dont il sera deux ans secrétaire général, et collaborateur du Journal des sciences et institutions médicales, dirigé par Buchez. Converti en mai 1830 au saint-simonisme, il suit Enfantin et devient membre du deuxième degré. Il participe à l'enseignement de la doctrine et dirige une maison commune ouverte en novembre 1831 pour héberger et nourrir les membres du troisième degré avec un dispensaire : étrange mélange d'aide sociale et d'œuvre évangélique, un peu analogue à notre Armée du Salut. Envoyé en mission à Orléans, puis à Metz en octobre et décembre 1831, Simon est appelé ensuite au Collège par Enfantin après le schisme de Bazard et il se joint l'année suivante à l'aventure de Ménilmontant, où il remplit la fonction de chef de cuisine.
Les travaux du ménage et du jardinage effectués, Enfantin réunit ses « fils » pour des discussions prolongées où se mêlent science, poésie, prophétisme et mysticisme. On trouve dans Le Livre Nouveau des saint-simoniens entre Simon et Enfantin un dialogue sur la médecine qui donne une idée du niveau scientifique de l'un et de l'autre. Enfantin demande à Simon de lui présenter des planches du système nerveux et du grand sympathique. Cela fait, il déplore qu'on ne connaisse pas grand-chose de leur fonctionnement :
— « Pour cela, il fallait, dit Simon, un autre dogme, une conception physiologique, vous l'avez. Les travaux qui seront faits dans la direction que vous indiquez jetteront un grand jour sur une foule de maladies inconnues. C'est par exemple l'épilepsie, l'hystérie, qui ne touche pas que les femmes, et tous les phénomènes magnétiques. Père, est-ce que vous ne vous occuperez pas de magnétisme animal ? »
— « Il n'est pas temps encore [...] mais les expériences magnétiques ne seraient concluantes pour moi qu'autant que je les ferais moi-même et sur des membres de la Famille. »
Après la fin de l'expérience de Ménilmontant, Simon reprend l'exercice de la médecine et collabore également avec Jallat et Boulland au Journal des sciences et institutions médicales de Buchez. C'est alors qu'il découvre une nouvelle médecine, l'homéopathie, basée sur les travaux du médecin saxon Hahnemann, qu'il contribue à répandre en France. Trop occupé par cette nouvelle mission, qu'il accomplit avec le même enthousiasme que pour la doctrine de Saint-Simon, il ne participe ni à l'aventure des compagnons de la femme, ni à l'expédition en Égypte. En 1833, Simon et son confrère alsacien Curie ouvrent une clinique consacrée à l'homéopathie, puis un dispensaire pour les classes populaires où ils assurent un enseignement. La même année, ils fondent la Société, puis le Journal de médecine homéopathique, qui se développent rapidement. Plus tard, en 1856, Léon Simon publie une Exposition de la doctrine médicale homéopathique ou Organon de l'art de guérir. Quelque temps auparavant, il avait écrit au ministre de l'Instruction publique pour protester contre la condamnation de l'homéopathie par l'Académie de médecine. Mais il garde intacte sa foi saint-simonienne et correspond fréquemment avec Enfantin, pour lequel il garde une vénération respectueuse. Il s'efforce de l'aider financièrement dans ses périodes difficiles et l'invite avec Curie à venir inaugurer « religieusement » le nouveau London homeopatic hospital. Lui-même, gravement malade depuis 1840, meurt le 13 mai 1867.
Suivant certains, Simon aurait aussi dirigé en 1833, à Nantes, le quotidien Le Breton. En réalité, il s'agit d'une erreur due à une homonymie, le rédacteur en chef et gérant responsable de ce journal étant un certain G. C. Simon.
Pierre Verrolot
Pierre Verrolot, né à Marseille en 1809 et devenu saint-simonien à vingt-deux ans, avait organisé à Troyes des réunions d'endoctrinement. Tenté par la médecine, il fait des démarches pour entrer au Val-de-Grâce, mais sans succès, et finalement s'inscrit, probablement, à l'École de médecine de Marseille.
Ses études l'empêchent de participer à l'expérience de Ménilmontant, mais il les abandonne pour suivre Enfantin en Égypte et, comme Cognat, assure le service médical sur le chantier du barrage dans des conditions difficiles. Il échappe toutefois à la peste de 1835 et au retour, passe sa thèse à Montpellier, en 1835.
Par la suite, à la recherche d'une situation, il reçoit une proposition pour devenir médecin du sultan de Darfour. Celui-ci lui offre 8000 francs par an, mais il y renonce. En 1837, il est devenu chirurgien du paquebot mixte Le Scamandre, qui fait le trajet Marseille-Alexandrie et parfois Marseille-Constantinople. C'est lui qui transmet le courrier de France aux saint-simoniens restés en Égypte. En juillet 1840, il écrit à Lambert pour lui demander de lui trouver un poste de médecin au Caire, où il voudrait expérimenter l'homéopathie dans le traitement du choléra qui a succédé à la peste. Il cherche ensuite à se faire engager comme médecin des paquebots qui seront bientôt construits à Saint-Nazaire pour le compte de la Compagnie Générale Transatlantique, création des frères Pereire. On perd ensuite sa trace.
Marius Villers
Médecin major de la marine, Marius Villers, dont les origines nous sont inconnues, est un converti de fraîche date lorsqu'il renonce à sa carrière. Dans sa lettre de démission, adressée de Rio de Janeiro au ministre de la marine, il invoque des raisons de santé et des problèmes familiaux.
Mais la vraie raison est tout autre. C'est parce qu'il se propose de prêcher la doctrine dans les corps de l'armée d'Afrique basés à Toulon. On ne sait pas si ce programme a été accompli. En tout cas, Villers ne participe ni à la communauté de Ménilmontant ni à l'expédition des Compagnons de la femme ni à l'aventure égyptienne.
Après la décadence de l'Église saint-simonienne, Villers ne retrouve pas son poste de chirurgien major dans la marine et, quelques années plus tard, il sollicite Enfantin, devenu administrateur de lignes ferroviaires, pour obtenir la place de médecin des chemins de fer à Lorient. Il semble ne pas l'avoir obtenue, et l'on perd sa trace.
Auguste Warnier (? -1875)

Ancien chirurgien militaire, Warnier réside en Algérie lorsqu'Enfantin y arrive en 1840, mandaté par le gouvernement pour faire partie d'une Commission de recherche et d'exploration de l'Algérie où il siège également. Warnier est converti au saint-simonisme par le chef de l'Église en personne. C'est « un gros homme, à la tignasse hirsute, autoritaire, indiscret, mais cœur excellent ». En 1835, Warnier est attaché au consulat que le gouvernement français a placé auprès d'Abd el Kader. Nul ne connaît la population indigène mieux que ce bourreau de travail. Enfantin trouve en lui un allié et un disciple précieux pour faire prévaloir ses idées sur la colonisation de l'Algérie. Soucieux du développement de la colonie, il propose de faire venir des colons, de France prioritairement, mais aussi, au besoin, des Allemands. Le duc d'Aumale rejette ce dernier projet. Puis Warnier et Enfantin ont l'idée de créer un périodique arabe qui s'adresserait à tout le monde musulman, mais serait édité à Paris. Sagement ils y renoncent au profit d'un journal français qui voit le jour en janvier 1844 sous le titre : L'Algérie, Courrier d'Afrique, d'Orient et de la Méditerranée. Véritable organe des saint-simoniens de la colonie, il se propose de lutter pour la transformation politique et économique de l'Algérie en y réduisant le pouvoir des militaires, en limitant les objectifs de la conquête à la colonisation des territoires occupés et en créant une administration civile. Il plaide aussi pour le développement de routes et d'organismes de crédit. Bien entendu, ce programme soulève l'ire des militaires, à commencer par Bugeaud contre lequel il tire à boulets rouges. Mais le journal qui est en permanence déficitaire et ne vit que de dons, finit par disparaître en juillet 1846.
Warnier, qui n'a pas été payé durant sa collaboration à L'Algérie, est ensuite nommé conseiller civil à Oran en septembre 1848, puis à Alger en octobre. Il y trouve comme directeur un saint-simonien, Frédéric Lacroix, qui deviendra préfet d'Alger l'année suivante.
À ce moment réapparaît Émile Barrault, l'exalté Compagnon de la femme qui n'a pas réussi à se faire nommer consul à Constantinople. Le gouvernement a estimé qu'après la mémorable expédition des Compagnons de la femme, Barrault n'est peut-être pas l'homme qu'il faut pour discuter avec le sultan. Barrault vient alors de se découvrir une vocation d'agriculteur et avec son enthousiasme habituel veut créer une colonie en Algérie. Warnier cherche aussi un retour à la terre. Tous deux sollicitent une concession au village de l'Arba, à sept lieues d'Alger, environ 150 hectares au pied de l'Atlas. Mais Barrault, qui a peu d'argent, est incapable de construire une maison. Il élève un gourbi où il s'installe. Totalement incompétent en agriculture et sous-équipé, l'ancien professeur de rhétorique au collège de Sorèze végète et bientôt s'enfonce dans la misère. Warnier, auquel le gouvernement a enlevé son emploi de conseiller civil, ne peut guère l'aider.
Il ne leur reste à tous deux qu'une ressource : la politique. Les élections de 1849 leur offrent un champ d'action. Warnier décide de poser sa candidature à Constantine ou à Oran, mais il échoue à Oran, tandis que Barrault est élu à Constantine. Comme on pouvait l'attendre, tous deux se brouillent. Warnier se trouve à son tour dans le besoin avec sa femme et ses deux enfants. Pour les faire vivre, il est réduit à copier des rôles d'huissier à dix centimes la page. Il a bien été chirurgien militaire, mais n'ayant pas exercé depuis douze ans, il est sûr d'avoir tout oublié et est trop honnête pour faire courir des risques à ses patients. La propriété de l'Arba est une charge, mais Barrault, son associé, lui refuse le droit de s'en défaire.
Warnier adjure Enfantin de le faire nommer préfet ou conseiller du gouvernement. Une autre fois, informé du projet d'un chemin de fer Alger-Blida, il lui suggère de l'associer à une spéculation sur les terrains, ou encore d'acheter des terres dans la Mitidja. Mais le Père fait la sourde oreille. « Tant que l'Algérie sera sous la coupe militaire, nous ne ferons pas un sou de travail dans ce pays ». D'ailleurs les conceptions des deux condisciples se séparent de plus en plus. Alors que l'ancien chirurgien privilégie les colonies de taille moyenne et qui ne dépouillent pas les indigènes de leurs terres, Enfantin, en vrai capitaine d'industrie qu'il est devenu, ne parle que vastes domaines, de routes, de chemins de fer et de banques, de crédit. D'ailleurs il n'a pas très confiance dans Warnier qu'il considère comme un rêveur, incapable de conduire des projets aussi grandioses.
En 1853 Auguste Warnier, décide d'acheter le domaine de Kandoury d'une superficie de 1000 hectares, auquel il ajoutera quelques années plus tard celui de Ben-Koucha, de 600 hectares Ces deux domaines, près du lac Halloulah, sont désolés par les fièvres et Warnier doit d'abord assainir les terrains, ce qui lui coûte fort cher. Il fait tout de même vivre une centaine de familles indigènes dans une remarquable exploitation agricole. Cependant, découragé par les difficultés de toutes sortes et les médiocres résultats, il revend ses domaines à François Arlès-Dufour, grand ami d'Enfantin et véritable banquier du groupe, qui l'acquiert pour son fils Armand.
Une carrière politique s'ouvre alors à lui. En 1870, il est nommé préfet d'Alger, mais poursuivi par son passé, il se heurte à l'opposition des plus exaltés des colons, qui l'obligent à démissionner. Sous la IIIe République, il se remet en selle et représente les colons modérés à la Chambre des députés. Peu à peu, oubliant sa foi saint-simonienne, il évolue vers une politique de plus en plus favorable aux colons. À ce titre, il est chargé en 1873 d'un rapport devant l'assemblée sur la préparation d'un projet de loi, appelée loi Warnier, concernant la propriété privée en Algérie. Le but était d'en finir avec la propriété collective des Arabes qui limitait la colonisation. On était loin alors des idées généreuses d'Enfantin. Warnier mourut à Versailles deux ans plus tard.

